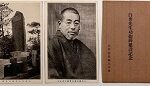Tokio Yokoi était-il le véritable fondateur du Reiki ?
Tokio Yokoi était-il le véritable fondateur du Reiki ?
Une analyse [1]
– par Justin B. Stein –

La littérature sur le Reiki regorge d’affirmations audacieuses selon lesquelles le fondateur du Reiki ne serait pas celui que nous croyions. Dans les années 1990, une figure nommée Lama Yeshe (né Richard Blackwell) prétendit avoir découvert des textes révélant que Mikao Usui avait reçu le Reiki par le biais d’un texte bouddhiste ésotérique jusque-là inconnu[2]. Au début des années 2000, de nouveaux récits émergèrent en ligne et lors de conférences internationales, affirmant qu’Usui était un artiste martial accompli dont les enseignements originaux étaient explicitement bouddhistes ; par la suite, certains avancèrent que des officiers militaires avaient dépouillé ces pratiques de leur influence bouddhiste et y avaient ajouté des éléments de vénération impériale lorsqu’ils fondèrent l’Usui Reiki Ryōhō Gakkai et prirent le contrôle de l’héritage d’Usui[3]. Certaines lignées et ouvrages prétendent, via des « canalisations », que le Reiki proviendrait de l’Égypte ou du Tibet anciens, voire qu’il aurait été transmis par des êtres extraterrestres.
En 2023 et 2024, deux Maîtres Reiki ont publié des livres portant une affirmation inédite : le véritable fondateur du Reiki ne serait pas Mikao Usui, mais plutôt Tokio Yokoi (1857–1927), un pasteur chrétien japonais, auteur et éditeur, qui avait été membre du parlement national. Cette affirmation extraordinaire est apparue pour la première fois dans The Samurai Reiki Master (2023) d’Elizabeth Latham, un ouvrage volumineux (l’édition brochée compte 749 pages) qui expose sa théorie selon laquelle Yokoi serait le véritable fondateur du Reiki, à travers les récits entremêlés de sa vie et du parcours personnel de Latham dans le Reiki. L’année suivante, Jojan Jonker (qui avait aidé à éditer l’ouvrage de Latham) publia Tokio Yokoi : From Japanese Christianity to Universal Reiki (2024), un volume concis qui concorde largement avec celui de Latham, tout en tirant quelques conclusions différentes. L’année passée, les livres et les arguments de Latham et Jonker ont attiré une attention considérable lors de webinaires, podcasts et dans les magazines / bulletins[4]. En effet, certains Maîtres Reiki commencent à enseigner au sujet de Yokoi dans leurs cours, et se rendent même en pèlerinage sur sa tombe[5].
On m’a demandé à plusieurs reprises mon avis sur les arguments de Latham et Jonker, qui, s’ils étaient valides, remettraient littéralement en question tout ce qui a été écrit jusqu’à présent sur l’histoire du Reiki. J’ai longtemps évité d’aborder ce sujet, mais après avoir exprimé un scepticisme initial de façon prudente et un nombre croissant de demandes pour connaître mon point de vue, j’ai décidé de prendre le temps d’écrire un véritable essai examinant les preuves avancées par Latham et Jonker pour étayer leur hypothèse. Ma conclusion est que les preuves en faveur de Mikao Usui comme fondateur du Reiki l’emportent largement sur celles présentées pour Yokoi, et qu’il est hautement probable que Yokoi n’ait eu aucun lien avec la fondation du Reiki. Il est possible que la biographie de Yokoi ait inspiré certains aspects du récit qu’Hawayo Takata fit d’Usui, ce qui, si cela s’avérait exact, constituerait une contribution significative à la recherche historique sur le Reiki. Malheureusement, un examen approfondi des livres de Latham et Jonker révèle que la plupart de leurs affirmations concernant les liens présumés de Yokoi avec le Reiki reposent sur très peu de preuves historiques.
Dans les pages suivantes, je vais esquisser brièvement l’hypothèse Yokoi et examiner les preuves et les raisonnements que Latham et Jonker avancent pour soutenir cette théorie inédite. Je présenterai ensuite les éléments attestant Mikao Usui comme fondateur du Reiki, avant de conclure par quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles la théorie peu plausible de Yokoi a trouvé un écho dans le monde du Reiki.
L’hypothèse Yokoi
Les arguments de Latham et Jonker diffèrent sur certains points, mais leur thèse principale est que le véritable fondateur du Reiki serait Tokio Yokoi, et que le Reiki serait, au fond, une pratique chrétienne japonaise, comparable à l’imposition des mains pour guérir par l’Esprit Saint, ce qu’ils affirment pouvoir être désigné par le terme japonais reiki 霊気 (bien que le terme plus courant serait seirei 聖霊).
Les deux auteurs décrivent la cérémonie d’initiation au Reiki en termes de « baptême par le Saint-Esprit », similaire à ce que vécurent les disciples de Jésus lors de la Pentecôte. Ils affirment que la biographie de Yokoi ressemble étroitement, et valide ainsi, le récit qu’Hawayo Takata fit d’Usui, dans lequel Usui se rendit aux États-Unis pour approfondir son étude du christianisme, à la recherche d’une validation des pouvoirs de guérison de Jésus tels que décrits dans les Évangiles.
Dans son livre, Latham soutient qu’il n’a jamais existé d’individu nommé Mikao Usui, mais plutôt que « l’identité de Tokio Yokoi a été dissimulée par Chujiro Hayashi, en utilisant le pseudonyme ‘Mikao Usui’… afin de protéger le Révérend Yokoi Sensei et sa famille… Selon mes découvertes, hormis Tokio Yokoi sous le pseudonyme de Mikao Usui, il n’existe absolument aucun dossier d’un homme portant le nom de ‘Mikao Usui’ au Japon qui puisse être lié au Reiki. »[6] De plus, elle affirme que l’association que l’on croit fondée par Usui, l’Usui Reiki Ryōhō Gakkai, n’a jamais existé[7]. Je reviendrai sur ces affirmations vers la fin de cet essai.
Jonker avance qu’il est plus probable que Yokoi et Usui aient été deux personnes différentes, et qu’Usui ait pu être un élève de haut rang de Yokoi. Il suggère que Yokoi aurait pu être écarté de la direction de son organisation Reiki, Usui étant nommé nouveau dirigeant et toute mention de Yokoi effacée, mais que certains éléments de la vie de Yokoi auraient été transmis à Takata par son maître Hayashi[8]. Toutefois, il n’écarte pas non plus la possibilité qu’Usui ait été un pseudonyme de Yokoi, ou peut-être son cousin, soulignant une ressemblance physique apparente entre les deux sur certaines photos[9], un autre point sur lequel je reviendrai plus loin.
La biographie de Yokoi et le récit du Reiki selon Hawayo Takata
Les arguments de Latham et Jonker reposent sur quelques similitudes entre la biographie de Yokoi et l’histoire de Mikao Usui que Hawayo Takata racontait à ses élèves dans les années 1970. Dans le récit de Takata, « le Dr Usui » était un ministre chrétien et le « directeur » de l’université Dōshisha, une université chrétienne renommée et prestigieuse située à Kyoto[10]. Takata affirmait que les étudiants mirent à l’épreuve la foi d’Usui dans les pouvoirs de guérison de Jésus, ce qui le poussa à démissionner de son poste pour aller étudier le christianisme aux États-Unis, spécifiquement à Chicago, afin d’apprendre comment Jésus était capable de guérir.
Il est en effet vrai que Yokoi fut le troisième président de Dōshisha et qu’il se rendit aux États-Unis pour suivre des études de théologie. Toutefois, Yokoi étudia aux États-Unis de 1894 à 1896, avant de devenir président de Dōshisha en 1897. De plus, Yokoi ne se rendit pas à Chicago pour y étudier le christianisme, comme le fit Usui dans le récit de Takata, mais à la Yale Divinity School à New Haven, dans le Connecticut. Cela peut sembler un simple détail, mais la principale preuve avancée pour faire de Yokoi le fondateur du Reiki repose sur le fait que sa biographie correspondrait au récit de Takata, et il faut forcer le trait pour faire coïncider même cet aspect. Inutile de dire que Latham et Jonker écartent largement les éléments du récit de Takata qui ne correspondent pas à la biographie de Yokoi : par exemple, lorsque Usui devient désillusionné par ses études chrétiennes et retourne à Kyoto pour s’immerger durant des années dans les études bouddhistes, ou encore lorsqu’il découvre une formule secrète dans des sutras sanskrits, qui devient la clé de sa réception ultérieure du système Reiki et des miracles de guérison qu’il accomplit.
Jonker affirme qu’en 1899, « durant l’un des cours de Tokio à Dōshisha, ses étudiants remirent en question sa foi… Peut-être fut-il alors mis au défi de démontrer des dons de guérison à la manière de Jésus. Il dut avouer qu’il ne le pouvait pas et démissionna en 1899 pour… rechercher et exercer effectivement le don de guérison. »[11] Cependant, comme cela arrive malheureusement trop souvent, Jonker n’apporte absolument aucune preuve de cette prétendue crise de foi de Yokoi. Il est vrai que Yokoi démissionna en décembre 1898, mais cette décision s’inscrivait dans une démission collective du personnel de Dōshisha, en raison d’une controverse concernant une révision de la charte de l’école visant à supprimer les références au christianisme, afin d’intégrer l’université dans le code civil japonais et de permettre aux étudiants d’être exemptés de la conscription[12]. Latham présente cette divergence avec la version de Takata de manière plus franche, concluant que son maître, Hayashi, aurait modifié l’histoire pour des raisons politiques[13].
Cependant, Latham avance elle-même des affirmations douteuses, telles que sa connexion répétée entre la description que Yokoi fait de son éveil spirituel en 1874 (près de cinquante ans avant le début de l’Usui Reiki Ryōhō, et vingt ans avant le départ de Yokoi pour les États-Unis) et le récit de Takata concernant l’expérience d’Usui sur le mont Kurama, qui semble avoir eu lieu au début des années 1920[14]. Latham souligne les similitudes entre les deux récits — chacun ayant eu lieu en montagne, sous un grand arbre, à l’aube — mais néglige d’en examiner les nombreuses différences. Par exemple, Yokoi lisait la Bible en groupe, tandis qu’Usui terminait une période de vingt et un jours de méditation et de jeûne en solitaire. Yokoi décrivit avoir ressenti la présence de Dieu dans les rayons du soleil levant, tandis que Takata racontait qu’une minuscule lumière surgit du ciel noir, se dirigea rapidement vers Usui et le frappa en plein front, le rendant inconscient. L’expérience d’Usui, telle que racontée par Takata, ressemble davantage à une célèbre histoire du moine bouddhiste japonais Kūkai, qui aurait pratiqué une méditation particulière dans les montagnes jusqu’à ce que l’étoile du matin (Vénus) émerge de l’obscurité, tombe du ciel et entre dans sa bouche[15].
Tout au long de son livre, Latham décrit l’expérience de Yokoi en termes de « baptême par le Saint-Esprit », mais il ne semble pas que Yokoi ait lui-même jamais utilisé cette expression. Autant que je puisse en juger, elle ne fournit aucune citation des écrits de Yokoi contenant ce terme. Il semble plutôt qu’elle emploie ce terme en raison de ses premières expériences du Reiki, qu’elle interprétait à travers le prisme du Saint-Esprit[16], et de son inclination à percevoir des liens entre l’imagerie pentecôtiste, la guérison charismatique chrétienne et le Reiki.[17] À un moment donné, Latham admet qu’elle ne dispose peut-être pas de beaucoup de preuves pour étayer ces liens, mais qu’il s’agit d’une « recherche intuitive » dans laquelle « [ses] doigts étaient guidés automatiquement par une force », apparemment le Saint-Esprit[18]. Bien que le terme « baptême par le Saint-Esprit » n’apparaisse pas dans les écrits de Yokoi, il constitue un élément central dans le récit que Latham et Jonker font de la prétendue fondation du Reiki par Yokoi.
Avant d’examiner plus en profondeur la question centrale du « baptême par le Saint-Esprit », je souhaite aborder un autre aspect de la vie de Yokoi que Latham cite à plusieurs reprises comme étant en accord avec l’histoire racontée par Takata : son temps passé comme prédicateur et missionnaire à Imabari, dans la préfecture d’Ehime, qu’elle relie à l’histoire de Takata selon laquelle Usui aurait passé sept ans dans les « bas-fonds » de Kyoto, soignant les mendiants avec le Reiki[19]. Ce lien est discutable. Imabari se trouve à environ 350 km à l’ouest de Kyoto, sur l’île de Shikoku. Latham tente de qualifier cet endroit de « taudis » parce que c’était un « pauvre village de pêcheurs », mais Imabari était une ancienne ville-château, l’une des plus grandes cités de Shikoku, et un important centre de construction navale. De plus, la chronologie de cette période ne correspond pas entre les deux récits : dans l’histoire de Takata, le temps qu’Usui passe dans les bas-fonds de Kyoto intervient à la fin de sa vie, menant à sa rencontre avec Hayashi, qui deviendrait son principal disciple ; alors que pour Yokoi, Imabari fut le lieu où il fit ses premières armes en tant que jeune ministre, avant d’enseigner à Dōshisha, puis d’en devenir le président.
Les prétendues expériences de Yokoi avec le « baptême par le Saint-Esprit » et la guérison spirituelle par imposition des mains
Au cœur des ouvrages des deux auteurs se trouve l’argument selon lequel la cérémonie aujourd’hui largement appelée initiations ou harmonisations Reiki (appelée à l’origine reiju 霊授) dériverait d’un rituel chrétien ésotérique qu’ils nomment baptême par (ou avec) le Saint-Esprit[20]. Latham la compare à la pratique indienne du shaktipat, qu’elle décrit comme une « infusion d’énergie… par un maître spirituel », qui peut être sous forme physique ou « l’esprit résident d’un grand maître… comme celui de Jésus par le Saint-Esprit »[21]. Elle établit à plusieurs reprises des liens entre le verset biblique Jean 20:22 (« Et, ce disant, [Jésus] souffla sur eux et leur dit : ‘Recevez le Saint-Esprit’ ») et les initiations Reiki, qui impliquent également une transmission par le souffle[22]. Malgré sa fixation sur ce passage, qu’elle appelle « le verset préféré de Tokio »[23], elle ne fournit jamais la moindre preuve que Yokoi ait cité ce verset dans ses écrits ou y ait été particulièrement attaché. Cela semble encore une fois découler de sa « recherche intuitive ».
Ces livres cherchent également à relier la pratique du Reiki à la guérison chrétienne charismatique, qui canalise le Saint-Esprit par l’imposition des mains. Latham affirme qu’après l’éveil spirituel de Yokoi en 1874 (vers l’âge de 17 ans), lui et ses compagnons (un groupe influent bien étudié, connu sous le nom de Kumamoto Band) parcouraient leur ville en imposant les mains pour guérir les malades et les blessés[24]. Sa seule preuve semble être une citation des mémoires d’un des associés de Yokoi, Michitomo (Paul) Kanamori, qui raconte qu’ils se sentaient appelés à suivre l’exemple de Paul, « travaillant de nos propres mains et prêchant l’Évangile »[25]. En dehors du livre de Latham, je n’ai trouvé aucun autre récit indiquant que le Kumamoto Band ait pratiqué la guérison par imposition des mains. Il semble que Kanamori faisait plutôt référence à 1 Thessaloniciens 4:11, où Paul de Tarse exhorte les chrétiens « à mener une vie paisible, à s’occuper de leurs propres affaires, et à travailler de leurs propres mains ». Il ne s’agit pas d’une référence à la guérison, mais plutôt à un travail énergique au service de l’évangélisation[26].
Jonker affirme que Yokoi « cherchait une version japonaise du baptême par le Saint-Esprit » dans le cadre de ses efforts pour localiser le christianisme, car il estimait que ce rituel « ne serait accepté par les Japonais que s’il était reconnaissable en termes de rituels bouddhistes et shintoïstes japonais »[27].
Jonker affirme également que Yokoi s’est rendu à l’École de théologie de Yale entre 1894 et 1896 parce qu’» il espérait découvrir comment le baptême par le Saint-Esprit pouvait être accompli »[28]. Là encore, les spéculations de Jonker ne sont étayées par aucune preuve montrant que Yokoi s’intéressait au « baptême par le Saint-Esprit ». De plus, un tel intérêt aurait été extrêmement inhabituel pour un membre de sa dénomination congrégationaliste et l’aurait probablement conduit à rejoindre l’un des mouvements chrétiens charismatiques qui prenaient forme au Japon à cette époque.
Dans la mesure où le baptême par/avec le Saint-Esprit et l’imposition des mains apparaissent dans l’histoire du christianisme japonais, c’est en lien avec les mouvements charismatiques de sanctification et de sainteté, qui ont débuté dans les années 1890[29]. Malgré les affirmations de Latham selon lesquelles Yokoi « suivait les méthodes d’évangélisation des chrétiens par la guérison par imposition des mains, à l’exemple de saint Paul l’Apôtre »[30], et que son Église congrégationaliste « pratiquait l’imposition des mains dans le cadre de son travail évangélique »[31], Yokoi et ses confrères congrégationalistes rejetaient sur le plan théologique les pratiques charismatiques telles que l’imposition des main. À ce sujet, j’ai contacté Emily Anderson, historienne du christianisme dans le Japon moderne, qui a confirmé que les congrégationalistes de Yokoi étaient « la dénomination la moins charismatique » et « auraient considéré [des pratiques comme l’imposition des mains pour guérir] comme anathèmes »[32].
Malgré l’importance centrale de l’intérêt supposé de Yokoi pour le « baptême par le Saint-Esprit » dans leur argumentation globale, Latham et Jonker ne fournissent aucune preuve de cette affirmation issue des écrits de Yokoi. Leurs déclarations selon lesquelles Yokoi s’intéressait au baptême par le Saint-Esprit et à la guérison spirituelle par imposition des mains ne semblent pas fondées sur des éléments concrets, mais plutôt sur leur projection de détails de l’histoire d’Usui racontée par Takata sur la biographie de Yokoi.
Affirmations d’une influence principalement chrétienne (plutôt que bouddhiste) dans le Reiki
Bien qu’ils adoptent des approches légèrement différentes, Latham et Jonker soutiennent tous deux que le Reiki a été développé comme une pratique fondamentalement chrétienne, avec d’éventuels éléments bouddhistes, shintoïstes et confucéens ajoutés dans le cadre du désir de Yokoi de « japoniser » le christianisme. Dans cette section, j’examine leurs divers arguments selon lesquels le Reiki est principalement influencé par le christianisme plutôt que par le bouddhisme, malgré le récit de Takata selon lequel Usui aurait étudié le bouddhisme pendant des années dans un temple de Kyoto, qu’il aurait découvert le secret du Reiki dans un sutra en sanskrit, et ses affirmations, des années 1930 aux années 1970, selon lesquelles le Reiki est « enraciné dans la pensée bouddhiste » et constitue un « secret bouddhiste »[33].
Latham écarte en grande partie l’aspect de l’histoire de Takata où elle décrit les années d’étude d’Usui dans un temple bouddhiste, affirmant plutôt que les « sutras » que Takata mentionnait étaient probablement des textes chrétiens. Elle poursuit : « La description de Takata selon laquelle les symboles Reiki seraient des symboles sanskrits tirés des Sutras est absurde. Car nous savons que la plupart des symboles étaient principalement des caractères chinois ou des kanji japonais anciens, pas du sanskrit. »[34] Ailleurs, elle déclare : « Je ne peux tout simplement pas voir le Reiki comme étant à l’origine un concept bouddhiste », car les symboles Reiki « ne sont même pas du texte sanskrit… Les symboles Reiki sont tous des caractères chinois. »[35] Ici, elle ignore la théorie bien établie selon laquelle le deuxième symbole du Reiki (utilisé pour les traitements mentaux / émotionnels) est dérivé du caractère Siddham (une forme stylisée de sanskrit utilisée dans le bouddhisme japonais) hrīḥ (Japonais kiriiku, voir Fig. 1), qui peut représenter soit Amitābha (Amida Buddha) soit Avalokiteśvara aux mille bras (Senju Kannon Bosatsu), tous deux associés à la compassion infinie[36].
En parlant de compassion, Jonker a soutenu que le fait que la compassion soit un aspect central du Reiki appuie une origine chrétienne, liée à la valeur chrétienne de l’agápē (l’amour). Son implication selon laquelle, avant la légalisation du christianisme dans les années 1870, le paysage religieux japonais était dépourvu de la valeur de compassion[37], est choquante pour quiconque connaît le bouddhisme, pour lequel la compassion (karuṇā en sanskrit ; jihi 慈悲 en japonais) est une vertu centrale. Latham reconnaît que bouddhistes et chrétiens partagent la valeur de compassion, mais elle estime que les valeurs du Reiki s’apparentent davantage à l’amour chrétien, qualifiant la compassion bouddhiste de « quelque peu plus passive » que celle des chrétiens, ajoutant : « on pourrait dire que la sagesse du Bouddha a conduit à une compassion sans passion. »[38]
Jonker cite également un passage tiré des propres écrits d’Usui pour défendre l’idée d’une influence chrétienne sur le Reiki des débuts. Dans l’Explication publique de l’enseignement (Kōkai denju setsumei), rédigée vers 1925 – le texte le plus long attribué à Usui, principalement sous forme de questions-réponses – Usui affirme que tous les êtres vivants possèdent un pouvoir de guérison, mais que les êtres humains, en particulier, ont ce pouvoir de façon spécifique. La traduction utilisée par Jonker rend ce passage ainsi : « en particulier, l’humain, en tant que seigneur de la création, possède un pouvoir remarquable », et Jonker commente ensuite que l’idée de l’humanité comme « seigneur de la création ».. « est une vision du monde très chrétienne, et atypique d’une vision japonaise. Cela fait partie d’un processus plus large qui a eu lieu en Occident, où les humains se sont éloignés et détachés de la nature. »[39] Il est compréhensible que l’on puisse tirer cette conclusion à partir de cette traduction en anglais. Cependant, le terme « seigneur de la création » est une traduction de l’expression japonaise banbutsu no reichō 万物の霊長, qui signifie approximativement « le chef spirituel de toutes choses », et qui a une longue histoire en Asie de l’Est. Cette expression apparaît dans le Livre des Documents (Shujing en chinois ; Shokyō en japonais), l’un des Cinq Classiques du confucianisme, vieux de plus de 2000 ans, et elle figure dans de nombreux textes japonais prémodernes[40]. Ainsi, lire ce passage dans le japonais original montre clairement que, contrairement à l’interprétation de Jonker, il ne soutient pas l’idée d’une influence chrétienne sur Usui ou sur le Reiki des débuts.
D’autres tentatives visant à relier l’histoire du Reiki au christianisme se révèlent encore plus hasardeuses. Par exemple, Jonker cite la traduction par Hyakuten Inamoto de la pierre commémorative d’Usui, qui fait référence aux « disciples avancés » d’Usui, puis il commente : « Pour moi, le mot disciples évoque [sic] les disciples du Christ. »[41] Inutile de préciser que la relation maître-disciple est un aspect important de nombreuses disciplines artistiques d’Asie de l’Est, et que le terme utilisé sur la pierre commémorative (kōtei 高弟) n’a aucune connotation chrétienne explicite. Ici, Jonker perçoit ce que son environnement chrétien l’a amené à projeter, influencé par un biais de confirmation.
Enfin, Latham affirme que « c’est un fait bien connu que Gautama Bouddha n’a pas accompli de « guérison par imposition des mains » ni de « miracles » », contrairement à Jésus, célèbre pour avoir « démontré compassion et amour à travers l’accomplissement naturel de [miracles de] guérison ».[42] Cependant, comme l’a écrit Phyllis Granoff, spécialiste de la littérature bouddhiste indienne, « il existe de nombreuses histoires dans les textes bouddhistes qui décrivent comment le Bouddha, par sa simple présence ou par le toucher de sa main, était capable de guérir. »[43] Les discussions de ces auteurs sur la supposée connexion du Reiki au christianisme plutôt qu’au bouddhisme ne sont pas convaincantes.
Les théories supposées de Yokoi sur la divinité impériale
Jonker avance l’hypothèse que Yokoi aurait développé une « nouvelle forme de théologie » dans laquelle l’empereur japonais, en raison de sa prétendue descendance directe des kami célestes du shintoïsme, pourrait être « placé au même niveau que Jésus : fils des dieux »[44]. Il avance cette idée pour expliquer pourquoi Yokoi aurait pu s’intéresser à la poésie impériale (gyosei 御製), qui constituait une pratique importante dans les débuts de l’Usui Reiki Ryōhō. Cependant, Jonker ne fournit aucune preuve que Yokoi, ou quiconque dans son entourage proche, ait pratiqué ce genre de culte impérial syncrétique chrétien : il s’agit de spéculations non étayées. Plus loin dans le livre, Jonker semble assimiler l’utilisation du terme « Nouvelle Théologie » dans cette section à un véritable mouvement chrétien japonais de l’ère Meiji appelé « Nouvelle Théologie » (shin shingaku 新神学)[45]. Cependant, le mouvement de la Nouvelle Théologie était généralement connu pour être « une forme plus rationnelle et humanitaire du christianisme, introduite d’Europe », qui cherchait à intégrer des idées compatibles issues du confucianisme et du bouddhisme[46], plutôt qu’une forme nationaliste de christianisme japonais qui aurait assimilé l’empereur à Jésus.
La biographie de Yokoi et d’autres versions de l’histoire du Reiki
Jonker affirme également que la biographie de Yokoi correspond à certains éléments de la vie d’Usui provenant de sources autres que Takata. Cependant, ces affirmations ne résistent pas à l’examen. Par exemple, la tradition orale au sein de l’Usui Reiki Ryōhō Gakkai dit qu’Usui était le secrétaire particulier du politicien Shinpei Gotō[47]. À un moment donné, Jonker affirme que Yokoi « a travaillé avec » Gotō à partir de 1901, lorsqu’il « a obtenu un poste au parlement japonais », puis il prétend plus tard que Yokoi « a travaillé pour Gotō »[48]. Il ne fournit aucune preuve pour étayer ces affirmations. De plus, Yokoi et Gotō n’ont pas travaillé au parlement japonais à la même époque. Yokoi a travaillé au ministère des Communications vers 1900, avant d’être élu à la Chambre des représentants en 1903, poste dont il a démissionné en 1909 à la suite d’un scandale de corruption, ce qui lui a valu une peine de cinq mois de travaux forcés[49]. Pendant ce temps, Gotō a exercé les fonctions de gouverneur civil du gouvernement colonial japonais à Taïwan (de 1898 à 1906), puis de directeur fondateur de la Compagnie des chemins de fer de Mandchourie du Sud (de 1906 à 1908), et enfin de secrétaire aux Communications et chef du Bureau des chemins de fer (de 1908 à 1912). L’idée de Jonker selon laquelle Yokoi aurait travaillé avec ou pour Gotō semble être un autre cas non étayé de vœu pieux.
Images de Yokoi et Usui
Au chapitre 7 de son livre, Latham soutient que la célèbre photo de Mikao Usui (Fig. 2, ci-dessous), publiée dans le « Livre Gris » (réalisé par la fille de Takata, Alice Takata Furumoto, en 1982), ne serait en réalité pas une photo d’Usui. Elle affirme qu’il n’existait qu’un seul exemplaire de cette image en Occident, lequel « aurait été directement prélevé sur la tombe d’Usui, [sic] au Japon par Mme Takata », et donné par Takata à son élève Maître, Fran Brown, qui l’aurait ensuite transmise à Paul Mitchell pour être utilisée dans le « Livre Bleu », produit par la Reiki Alliance en 1985[50]. Latham avance ensuite que la photo que l’on croit être celle d’Usui serait soit une fraude totale, soit en réalité une photo du cousin germain de Tokio Yokoi, l’écrivain Kenjirō Rōka Tokutomi (1868–1927, Fig. 3), que Hayashi aurait donnée à Takata[51]. Jonker remet lui aussi en question l’authenticité de la photo d’Usui, affirmant qu’elle « n’a jamais vraiment été vérifiée » et prétendant qu’il existe des similitudes faciales entre Usui, Tokutomi et Yokoi (Fig. 4)[52].
(de gauche à droite, Fig. 2 : Mikao Usui ; Fig. 3 : Kenjirō Rōka Tokutomi ; Fig. 4 : Tokio Yokoi)
Indépendamment des ressemblances physiques entre les hommes sur ces photos, le récit de Latham présente plusieurs problèmes. Malgré son affirmation selon laquelle Takata aurait donné son unique exemplaire de la photo d’Usui à Fran Brown, Phyllis Lei Furumoto (successeur et petite-fille de Takata) a hérité d’un grand tirage encadré de cette photographie, qui se trouve aujourd’hui dans les Hawayo Takata Papers à l’Université de Californie, à Santa Barbara.
Comme vous pouvez le voir sur la Fig. 2 ci-dessus, le tirage comprend le texte japonais suivant : Fondateur (chōso) de l’Usui Reiki Ryōhō, Maître Usui ⾅井霊気療法肇祖⾅井先⽣.[53]
Ce même tirage figurait également dans une série de cartes postales produites en 1928 pour les membres de l’Usui Reiki Ryōhō Gakkai, après qu’ils eurent érigé la stèle commémorative d’Usui à Tokyo (Fig. 5)[54]. Ainsi, les idées selon lesquelles la photo d’Usui serait une fraude, que Hayashi aurait donné à Takata une photo de Tokutomi, ou que la photo d’Usui serait « non vérifiée », sont sans fondement. Plusieurs tirages de cette photo ont survécu à la période d’avant-guerre, tant au Japon qu’en possession de Takata.
Preuves en faveur d’Usui comme véritable fondateur du Reiki
Latham et Jonker affirment tous deux qu’il existe peu de preuves historiques documentant la vie de Mikao Usui et le décrivant comme le fondateur de l’Usui Reiki Ryōhō. Latham soutient qu’il n’existe « absolument aucun registre d’un homme du nom de ‘Mikao Usui’ nulle part au Japon pouvant être relié au Reiki »[55]. Jonker ne va pas aussi loin, mais reconnaît que « très peu de faits sur la biographie de Mikao Usui ont pu être retrouvés, et encore moins vérifiés ou réfutés »[56]. Bien qu’il soit vrai que la vie d’Usui soit peu documentée, leurs affirmations reposent sur un rejet délibéré de l’abondance de preuves qui attestent de la vie et de l’époque d’Usui.
La preuve la plus évidente de la vie d’Usui est la grande stèle commémorative que l’Usui Reiki Ryōhō Gakkai a érigée dans le temple Saihōji, de la secte Jōdo-shū (Terre Pure), à Tokyo, en mars 1927, à l’occasion du premier anniversaire de la mort d’Usui. Latham pense qu’aucune tombe de cette zone n’a survécu aux incendies provoqués par les bombardements américains de 1945 et que le mémorial qui s’y trouve aujourd’hui est une contrefaçon en « béton coulé » créée après la guerre, voire aussi tard que dans les années 1980[57]. Jonker cite les doutes de Latham mais ne prend pas position sur cette question, bien qu’il envisage la possibilité que la stèle ait été détruite pendant la guerre et qu’une réplique ait été réalisée[58]. Cependant, si l’on se rend à Saihōji (et que l’on sait lire le japonais), on verra que de nombreuses pierres tombales de ce cimetière datent d’avant la guerre et ont survécu aux terribles incendies de 1945. Devons-nous croire qu’elles sont toutes des faux ? Et même si le temple (en bois) et les bâtiments environnants ont été détruits, pourquoi les tombes en pierre et le monument d’Usui n’auraient-ils pas pu survivre à un incendie ? De plus, l’ensemble de cartes postales de 1928 mentionné précédemment, imprimé par l’Usui Reiki Ryōhō Gakkai (Fig. 5), contient une photo de la stèle ainsi qu’une page imprimée de son texte. Enfin, si l’on se rend personnellement sur le site de la tombe, il est clair qu’il s’agit d’une véritable pierre gravée, et non de béton coulé.
Un autre texte contenant une biographie détaillée d’Usui se trouve dans un livre de 1928 intitulé Tenrai no koe (La Voix de la Flûte du Ciel) de Shigejirō Okuna, conservé à la Bibliothèque de la Diète nationale. Le récit d’Okuna s’aligne étroitement avec les détails de l’inscription commémorative et l’histoire de Takata, incluant le lieu de naissance d’Usui dans la préfecture de Gifu, ses trois semaines de jeûne sur le mont Kurama, les miracles de guérison qu’il aurait accomplis en redescendant de la montagne, ainsi que son enseignement des cinq préceptes et la récitation des 100 gyosei[59]. D’autres références à Usui comme fondateur de l’Usui Reiki Ryōhō dans la littérature japonaise d’avant-guerre peuvent être trouvées dans un article de 1928 par l’élève de Hayashi, Matsui Shōyō[60], dans un livre de 1933 par un ancien élève de l’Usui Reiki Ryōhō nommé Tomita Kaiji[61], et dans un livre de 1935 par Taniguchi Masaharu (fondateur de la nouvelle religion Seichō no Ie), qui critiquait Usui pour les honoraires élevés qu’il exigeait pour enseigner la guérison par imposition des mains après avoir développé ses capacités de guérison durant une période de jeûne en montagne[62]. De plus, les mémoires de Gizō Tomabechi, homme d’affaires et politicien à succès qui avait été l’un des élèves d’Usui au niveau shihan (instructeur/Maître), contiennent un chapitre décrivant ses souvenirs des soins donnés par Usui, comment les traitements d’Usui Reiki Ryōhō ont amélioré sa santé et celle de ses patients, ainsi que les cinq préceptes qu’il avait appris d’Usui[63].
Cela sans même mentionner les nombreuses publications de l’Usui Reiki Ryōhō Gakkai, dont Latham affirme qu’elles n’ont jamais existé[64]. Olaf Böhm, qui possède peut-être la collection la plus complète au monde de ces documents, détient des copies de nombreux documents du Gakkai datant des années 1920 et 1930, incluant des copies des enseignements d’Usui (le Kōkai denju setsumei ou Explication publique de l’enseignement mentionné précédemment), des annuaires de membres, des guides de traitement, des règlements de l’organisation, un recueil de 100 poèmes de l’empereur Meiji (gyosei), ainsi que l’ensemble de cartes postales déjà évoqué (Fig. 5). Certaines photos et traductions de ces documents peuvent être consultées dans le livre récent de Böhm[65].
Enfin, si l’on se rend dans la ville natale d’Usui (village de Taniai, Yamagata, dans la préfecture de Gifu), un torii en pierre (portail sacré) porte les noms gravés de Mikao Usui, de ses frères San’ya et Kun’iji Usui, ainsi que de leur père Uzaemon Usui. Ce portail est daté d’avril 1923, et l’adresse de Mikao Usui à Tokyo y est inscrite (Fig. 6, ci-dessous)[66]. De plus, il existe des preuves, incluant des certificats signés de l’Usui Reiki Ryōhō Gakkai et d’autres publications, montrant que Kun’iji est devenu shihan (instructeur)[67] de l’Usui Reiki Ryōhō. Cela constitue une preuve manifeste que Mikao Usui était bien une personne réelle, née sous ce nom, et non un pseudonyme de Yokoi ou de Tokutomi
Conclusions
Comme je l’ai démontré, une grande partie des arguments de Latham et Jonker ne sont pas étayés par des preuves. Ils montrent que certains éléments du récit de Hawayo Takata sur Mikao Usui ressemblent à des éléments de la biographie de Tokio Yokoi : à savoir, tous deux ont dirigé l’université Dōshisha, tous deux ont démissionné, tous deux ont étudié le christianisme aux États-Unis, et tous deux ont travaillé auprès des pauvres. Cependant, ces éléments apparaissent dans un ordre différent dans leurs récits respectifs, et de nombreux autres aspects sont incohérents. De plus, la partie la plus essentielle de l’argumentation de Latham et Jonker repose sur l’idée que Yokoi s’intéressait à la guérison spirituelle par imposition des mains et au « baptême par le Saint-Esprit », et ils ne présentent aucune preuve à l’appui de cette affirmation, malgré les nombreux livres et articles que Yokoi a écrits sur ses croyances religieuses et ses activités.
En comparaison, malgré le scepticisme de Latham et Jojan sur le fait qu’Usui soit le fondateur du Reiki (ou même qu’il ait existé), il existe une relative abondance de preuves montrant que c’est bien le cas. Le nom et la vie d’Usui ont été gravés dans la pierre dans les années 1920, le décrivant comme le fondateur du Reiki, et des photos du mémorial d’Usui datant des années 1920 existent toujours. De nombreux textes publiés dans les années 1920 et 1930 (par l’Usui Reiki Ryōhō Gakkai et par des écoles concurrentes) relatent la vie et les enseignements d’Usui, et son élève Tomabechi Gizō a également publié plus tard ses souvenirs personnels d’Usui et de ses enseignements.
Il est remarquable que Latham et Jonker reconnaissent tous deux dans leurs livres que leurs arguments reposent en grande partie sur l’intuition et la spéculation plutôt que sur des preuves tangibles. Lorsque Latham décrit sa méthode de « recherche intuitive », dans laquelle ses « doigts étaient guidés automatiquement par une force », elle poursuit : « Je ne dis pas qu’il faut accepter ma suggestion sur l’origine du Reiki… Tout au moins, j’ai écrit un livre sur un homme merveilleux », à savoir, Tokio Yokoi[68]. Et vers la fin du livre de Jonker, il écrit aussi : « Je me rends compte que ce que je présente est hautement spéculatif. »[69]
Alors, pourquoi ces livres — qui vont à l’encontre de tout ce que l’on sait sur les origines du Reiki et nous demandent d’ignorer les preuves relativement abondantes concernant l’existence d’Usui — ont-ils reçu autant d’attention ? C’est maintenant à mon tour de spéculer, car j’ai peu de preuves directes pour répondre à cette question.
Premièrement, je dois aborder l’attrait de la théorie selon laquelle le Reiki serait fondamentalement une pratique chrétienne. Des interprétations explicitement chrétiennes du Reiki remontent au moins au début des années 1980, lorsque Ethel Lombardi créa Mari-El[70]. Plus tard, William Lee Rand développa le Holy Fire® Reiki, qui « utilise les concepts de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus »[71], et qui est aujourd’hui l’une des formes les plus populaires de Reiki. Le récit dominant autour de la pratique du Reiki est qu’elle est non religieuse et compatible avec toutes les religions du monde, mais il est également clair que de nombreux praticiens sont attirés par une présentation de leur pratique du Reiki en termes chrétiens. Ce désir d’une forme chrétienne de Reiki attire sans doute certains vers cette nouvelle théorie selon laquelle le Reiki serait un terme japonais pour désigner le Saint-Esprit, et que l’initiation Reiki serait essentiellement une pratique chrétienne ésotérique remontant aux temps bibliques.
Deuxièmement, je pense qu’il existe un élément de biais de confirmation concernant le désir (peut-être inconscient) de valider l’histoire racontée par Hawayo Takata. En psychologie, le biais de confirmation est la tendance à rechercher des informations qui confirment nos croyances préexistantes et à ignorer les données qui les contredisent. Pour les Maîtres Reiki enseignant l’histoire d’Usui telle que transmise par Takata depuis des décennies, les éléments contradictoires peuvent paraître menaçants, tandis que celles qui la corroborent apparemment peuvent sembler valorisantes. Les différences entre le récit de Takata sur Usui et la biographie de Yokoi semblent l’emporter sur les similitudes, mais une « volonté de croire » a probablement conduit certains à accepter une théorie qui prétend valider l’histoire de Takata et à ignorer l’improbabilité de certaines affirmations plus extravagantes (notamment les allégations de fraude, comme la véracité de la stèle commémorative).
Troisièmement, il y a le charisme et l’autorité de Jojan Jonker, qui a passé des années à bâtir une bonne réputation dans la communauté Reiki, et que je considère comme un ami et un collègue depuis plus d’une décennie. Il a consacré des années à la préparation d’un doctorat dans une prestigieuse université européenne (l’Université Radboud de Nimègue) pour mieux comprendre l’histoire du Reiki et a partagé avec énergie ses découvertes avec la communauté Reiki. Lui (et moi) avons consacré de nombreuses heures à construire la communauté « Circle of Scholars » au sein de Reiki Home, une organisation qui valorise l’inclusivité, où nous avons cherché à adopter une vision compréhensive de la diversité du Reiki, tout en faisant preuve de rigueur critique. Jonker est devenu un fervent promoteur de l’hypothèse Yokoi depuis 2023, promouvant le livre de Latham dans son réseau et lors d’événements et publications, allant jusqu’à écrire son propre livre sur le sujet. Il a discuté avec moi à plusieurs reprises pendant qu’il aidait Latham à éditer son livre, puis lors de la rédaction du sien, m’assurant que je trouverais l’argumentation et les preuves convaincantes. Inutile de dire que ce n’est pas le cas, et toute cette affaire me laisse quelque peu attristé quant à l’état de la recherche empirique sur l’histoire du Reiki.
Dire que je suis un peu nerveux quant à la réception de cet essai serait un euphémisme. Jonker et moi sommes suffisamment amis pour que je pense que nous pourrons accepter d’être en désaccord, même s’il veut ignorer ou répondre à mon analyse. Malheureusement, Latham a l’habitude de publier des commentaires péjoratifs en ligne lorsque ses arguments sont remis en question. Cependant, je ferai de mon mieux pour « ne pas m’inquiéter » (shinpai suna), juste pour aujourd’hui, et je fais confiance à la majorité de la communauté Reiki pour, munie des faits, distinguer la réalité de la fantaisie et reconnaître que les preuves soutiennent largement Usui comme véritable fondateur du Reiki.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
[1] Veuillez noter que, conformément à la littérature à laquelle je réponds, j’écrirai les noms japonais dans le style occidental (nom de famille en dernier).[2] Lama Yeshe, Medicine Dharma Reiki : An Introduction to the Secret Inner Practices with Extensive Excerpts from Dr. Usuiʼs Journals (Delhi : Full Moon Publishing, 2001). Yeshe a ensuite admis qu’il n’avait pas découvert physiquement les textes comme décrit dans son livre, mais qu’ils étaient issus d’informations « canalisées ». L’» information canalisée » désigne une connaissance acquise auprès d’esprits, de Dieu(x), ou d’êtres d’un autre monde, par l’écriture automatique, en état de transe, vision, rêve, etc.[3] Ces affirmations ont commencé avec Chris Marsh et Andrew Bowling et furent promues dans les cours qu’ils enseignaient et lors des conférences internationales sur l’Usui Reiki Ryōhō. Elles culminèrent avec le livre autoédité de Dave King, O-Sensei : A View of Mikao Usui, deuxième édition (Lulu.com, 2007).[4] Le numéro de printemps 2024 du Reiki Magazine, en langue allemande, a publié une critique quelque peu réservée du livre de Latham, accompagnée de deux articles sur le sujet : l’un par le rédacteur en chef, et l’autre par Jonker. En fin d’année, au moins quatre webinaires et interviews de podcasts furent consacrés au sujet. Enfin, le numéro de décembre 2024 du bulletin de la Reiki Alliance inclut une brève critique élogieuse du livre de Jonker.[5] Communication personnelle, Jojan Jonker à l’auteur, 15 janvier 2025.[6] Elizabeth Latham, The Samurai Reiki Master (livre électronique autoédité, édition du 16 août 2023), chap. 38.2. Étant donné que je dispose d’une édition électronique (qui semble être le principal mode de diffusion de ce livre), toutes les citations de Latham se réfèrent au numéro de chapitre et de section plutôt qu’à des numéros de page.[7] Latham, Samurai, chap. 38.2.[8] Jojan Jonker, Tokio Yokoi : From Japanese Christianity to Universal Reiki (mijnbestseller.nl, 2024), pp. 123–128.[9] Jonker, Yokoi, pp. 5, 121–122.[10] Extrait d’une transcription d’un enregistrement de 1979 : voir https://www.reiki.org/mrs-takata-talks-about-reiki.[11] Jonker, Yokoi, p. 72.[12] Fuse Tomoko, « ‘Dōshisha kyōiku kōryō’ tokutei katei ni kan suru ichi kōsatsu », Kirisutokyō kenkyū 84:1 (2022), pp. 39–63, p. 43 ; Ōsako Akifumi, « Shiritsu kōtō kyōiku kankei no minpō ni yoru hōninka katei », Tōhoku Daigaku Daigakuin kyōikugaku kenkyūka kenkyū nenpō 52 (2004), pp. 87–104, pp. 92–95.[13] Latham, Samurai, chapitres 31–32.[14] Latham, Samurai, chap. 19.9–19.10 ; 36.1.[15] Melissa Anne-Marie Curley, « Radiance and Darkness: Japanese Buddhist Cosmographies », dans Intersections of Religion and Astronomy, édité par Chris Corbally, Darry Dinell, et Aaron Ricker (Routledge, 2020), pp. 153–154. Voir aussi Gaynor Sekimori, « Star Rituals and Nikkō Shugendō », Culture and Cosmos 10:1/2 (2006), pp. 233–234 ; Taiko Yamasaki, « A Morning Star Meditation », dans The Life of Buddhism, édité par Frank E. Reynolds et Jason A. Carbine (University of California Press, 2000), pp. 100–101.[16] Latham, Samurai, ch. 2.8.[17] Latham, Samurai, chs. 14, 15.1, 19.7.[18] Latham, Samurai, ch. 15.1. In the book’s conclusion (ch. 37) she ofers some other theories about the “force” that guided her, saying that it could have been the spirits of Hayashi, Takata, and Yokoi.[19] Latham, Samurai, chs. 1, 7.2, 22.6, 25.3, 28.5, 32.1, 36.1, 38.1.[20] Latham utilise également cette expression de manière interchangeable avec « baptême par le feu ». Voir chapitres 8, 14, 21.2, 28.[21] Latham, Samurai, chapitre 19.10.[22] Latham, Samurai, chapitres 14, 22.4, 36.1, 38.1.[23] Latham, Samurai, chapitre 36.1.[24] Latham, Samurai, chapitres 19.7–8.[25] Paul M. Kanamori, Kanamori’s Life-Story (Philadelphie : The Sunday School Times Company, 1921), p. 15.[26] Les spécialistes de la Bible affirment que cette expression est une formule juive qui reflète la valorisation juive du travail physique par Paul, en contraste avec le mépris des élites gréco-romaines pour le travail manuel. Voir Ben Witherington III, 1 and 2 Thessalonians: A Socio-Rhetorical Commentary (William B. Eerdmans Publishing Co., 2006), pp. 122–124.[27] Jonker, Yokoi, p. 34.[28] Jonker, Yokoi, p. 67.[29] Ikegami Yoshimasa, « Holiness, Pentecostal, and Charismatic Movements in Modern Japan », dans Handbook of Christianity in Japan, édité par Mark R. Mullins (Brill, 2003), pp. 128–131.[30] Latham, Samurai, chap. 38.[31] Latham, Samurai, chap. 32.[32] Emily Anderson, communication personnelle à l’auteur, 8 février 2025.[33] Voir Stein 2023, pp. 112, 168, 182 ; « Reiki Ryōhō no Takata fujin: Beitairiku no tabi kara kiha » (Mme Takata de la thérapie Reiki : retour à Hawaï depuis le continent américain), Hawaii Hochi, 2 juillet 1938 ; Sally Hammond, We Are All Healers (New York : Harper and Row, 1973), p. 264 ; Mary Straub, « Reiki : Japanese Method of Healing Could Spark Public Interest Similar to Chinese Acupuncture », Tinley Park Times Herald, 13 novembre 1974, p. 13.[34] Latham, Samurai, chap. 2.31.[35] Latham, Samurai, chap. 32.1.[36] Voir, par exemple, Frank Arjava Petter, This is Reiki: Transformation of Body, Mind and Soul from the Origins to the Practice (Lotus Press, 2012), p. 153.[37] Jonker, Yokoi, pp. 24–26 ; « A Fascinating New Perspective on the History of Reiki », Reiki Rays Conference, 10 novembre 2024.[38] Latham, Samurai, chap. 16.3.[39] Jonker, Yokoi, p. 82. Jonker ne cite pas de source pour cette traduction, mais il semble qu’elle provienne de celle diffusée par Andrew Bowling en 1999. Voir : https://www.reiki.fi/english/reiki/manual/Usui_hikkei.htm [40] Nihon kokugo daijiten (Dictionnaire complet de la langue japonaise de Shogakukan), cité sur https://kotobank.jp/word/万物の霊長-607279#w-607279 [41] Jonker, Yokoi, p. 119.[42] Latham, Samurai, chap. 2.31. [43] Phyllis Granoff, « The Buddha as the Greatest Healer: The Complexities of a Comparison », Journal Asiatique 299:1 (2011), pp. 5–22, p. 21. Voir aussi Phyllis Granoff, « The Ambiguity of Miracles: Buddhist Understandings of Supernatural Power », East and West 46:1/2 (juin 1996), pp. 79–96, pp. 91–93. [44] Jonker, Yokoi, p. 37. [45] Jonker, Yokoi, p. 47. [46] Yamaguchi Aki, « Awakening to a Universalist Perspective: The Unitarian Influence on Religious Reform in Japan », The Eastern Buddhist (nouvelle série) 37:1–2 (2005), pp. 135–159, p. 147. [47] Petter, This is Reiki, pp. 43–44. [48] Jonker, Yokoi, pp. 75, 112. [49] (Wikipedia en japonais), « Nihon seitō oshoku jiken », https://ja.wikipedia.org/wiki/日本製糖汚職事件, dernière consultation le 8 février 2025. [50] Latham, Samurai, chap. 7.2. Paul Mitchell affirme que Latham se trompe, et qu’il a reçu la photo de Phyllis Furumoto, qui l’avait reçue de sa mère Alice. Communication personnelle à l’auteur, 15 février 2025. [51] Latham, Samurai, chap. 7.2. [52] Jonker, Yokoi, pp. 5, 121–122. [53] Comme beaucoup de légendes horizontales japonaises d’avant-guerre, les caractères sont écrits de droite à gauche. [54] Usui Reiki Ryōhō Gakkai, Usui-sensei kudoku hi kensetsu kinen (Usui Reiki Ryōhō Gakkai, 1928). Plus d’informations sur ces cartes postales dans Olaf Böhm, Reiki – A Journey to Oneness with the Universe: Early Documents and Practices of Usui Mikao Sensei’s Reiki Therapy (Books on Demand, 2025). [55] Latham, Samurai, chap. 38.2. [56] Jonker, Yokoi, p. 4. [57] Latham, Samurai, chap. 8.5. [58] Jonker, Yokoi, pp. 115–117. [59] Okuna Shigejirō 奥名滋次郎, Tenrai no koe 『天籟の声』 (Senbai Kyōkai, 1928), pp. 10–20. Ma traduction d’une section de ce texte figure dans Böhm, Journey to Oneness. [60] Matsui Shōyō 松居松翁, « Sekishu manbyō o ji suru ryōhō » 「隻手萬病を治する療法」, Sunday Mainichi, 4 mars 1928, pp. 14–15. Ma traduction de ce texte apparaît dans Robert Fueston, Reiki: Transmissions of Light, Volume 1 – The History and System of Usui Shiki Reiki Ryoho (Lotus Press, 2017), pp. 246–275. J’ai précédemment écrit le prénom de Matsui comme Shōō, mais il semble qu’il se lise en réalité Shōyō. [61] Tomita Kaiji 富田魁⼆, Reiki to Jinjutsu – Tomita-ryū Teate Ryōhō 『霊気と仁術―富田流手あて療法』 (Teate Ryōhōkai, 1933), p. 7. [62] Taniguchi Masaharu 谷口雅春, Seimei no jissō, daisankan: seire-hen / jisshō-hen 『生命の実相—第三巻—聖霊篇•実証篇』 (Nippon Kyōbunsha, 1935), pp. 41–42. [63] Tomabechi Gizō 苫米地義三 et Nagasawa Genkō 長沢玄光, Tomabechi Gizō Kaikoroku 『苫米地義三回顧録』 (Asada Shoten, 1951), pp. 335–350. [64] Samurai, chap. 38.2. [65] Böhm, Journey to Oneness. [66] Photos de l’auteur. [67] Böhm, Journey to Oneness. [68] Latham, Samurai, chap. 15.1. [69] Jonker, Yokoi, p. 128. [70] Fueston, Transmissions, p. 214. [71] William Lee Rand, « Clarity about Holy Fire® Reiki », https://www.reiki.org/clarity-about-holy-fire-reiki Il convient de mentionner que Rand précise que « ces concepts ne sont pas utilisés dans un contexte religieux ».